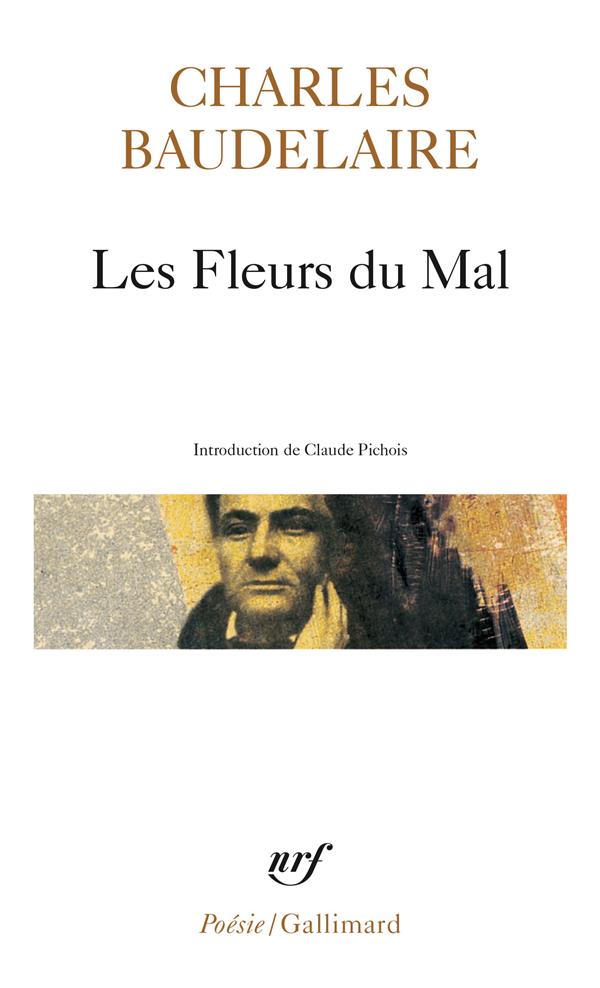0
Babel, c’est bien sûr la chute d’une Tour, et après, grande confusion et manipulation de paroles.
Babel, c’est aussi babil, commencement de la langue, avant qu’elle ne soit langue, quand elle est encore chant.
Babel, c’est donc un début et un écroulement – Ground Zero, du moyen-anglais grund et de l’arabe zefir, chiffre, latinisé en zéro.
Babel, c’est défi lancé au démiurge, insolence du cœur, ziggourat pointée vers des soleils à naître, dans la bouche la bouche comme désir : l’homme crée les dieux.
Où avant se dressaient le Phallus du Nord et le Phallus du Sud bée désormais une fente embrasée, fumées au gré des vents.
La fumée contient des corps ; nous nous entre-respirons. Ainsi Babel, c’est Kaboul. Nous nous entre-respirons.
Comme Arès couve toutes les capitales du monde : fragments de sièges tournoyant hors de cockpits détournés, des étrangers qui s’éberluent devant des cratères de Mars.
Babel, c’est Kaboul : Babel, c’est une Bible dans une commode de motel à Birmingham, Alabama : Babel, c’est l’esplanade de Battery Park et les passagers en attente à l’aéroport de Santo Domingo.
Babel, c’est la plus jolie fille de tout Kashgar, cheveux noirs, yeux noirs, peut-être treize ans, en robe rouge écarlate, qui fixe avec admiration l’étrangère entrée par hasard dans sa ruelle, et doucement, timidement, articule cette seule phrase en anglais, adressée à la dame : ‘How do you do ?’
Babel est bravoure, ses bourses en ont fait baver, notre métropole démesurée continue à viser les sommets.
Babel, c’était la Mésopotamie, seule superpuissance de son temps, retombées de Gilgamesh, Irak d’aujourd’hui.
Babel, c’est Bagdad, Babel, c’est Belgrade, Babel, c’est notre balcon, un centre qui sans cesse se déplace et se renomme – World/Trade/Center.
Babil en trois langues, babil en trois mille langues : mets donc une bavette.
Un bébé babillait de lions qui mangent des livres. Et les lions mangeaient des livres : Babel, ce sont des livres dans les rayons de la Bibliothèque Invertie.
Rien de vil à Babel : la parole de l’un est la muse de l’autre. Alors : les bombarder de beurre.
Voici la lame qui abolit Babel, voici les sillons où Babel commence, que nulle semence ne peut boycotter.
Babel rince ses géniteurs dans le chagrin, Babel récompense ses créateurs avec des couleuvres, Babel est naissance, reconstruisant avec des grues toutes sortes de crimes, de même que la vie est un poignard, que toute guerre commence dans quelque débâcle de lit.
Qui se rasa le con au cutter : nés des décombres, ‘ba’ pour papa, ‘ma’ pour maman, des babouins sacrés en patrouille à ses frontières.
Babel est Bouddha qui se passe de mots, Babel est accouplement, tonnerre, blanc de baleine et pluie, Babel est opprobre, Babel est hache et axe, Babel est Bush-ben-Laden et les médias.
Tandis que de hautes façades s’effritent comme parois de schiste, montagnes dévergondées, le Capitaine FBI ne peut que s’excuser au passage ‘Bavure’.
Babils de vagues, babils de quais, de marchands, d’entrepôts, ville fière de son fer et de ses cerveaux : babil vantardise babil sermon babil ce mot sur le bout de la langue ou les ennuis qui palpitent dans les naseaux du taureau.
Je tombe avec la Tour de Babel.
Jamais je ne peux me réjouir d’un brin d’herbe si je ne sais qu’il y a tout près une bouche de métro ou un magasin de disques ou quelque autre signe que les gens ne regrettent pas complètement de vivre.
Ça bégaie, ça bascule, pierre lisse comme peau, tours qui oscillent comme des tours oscillent dans le vent, comme nous sommes les marionnettes à demi consentantes de la langue.
C’est le boulanger aux gâteaux trop chauds, aux crêpes collantes, aux pains pétris de peine.
C’est chair couverte de saumure, bitume craquelé de fièvre, loups dans le sang qui hurlent au cœur gibbeux.
Babel c’est le baseballeur battu qui pète les plombs ; Babel c’est un glaçon dans la bouche aussi mélodieux qu’une flûte, aussi percutant qu’un tambour.
Tour dont les vrilles tordues ressemblent à la vigne, destruction exigée par le Dionysos de l’orient rencontrant l’occident, refus de consentir à toute perte de soi.
Babel n’est que célébration des mots, discours armé de torches, rêves chavirés par des rêves plus grands, la vérité de tout cratère, le double bang qui vous réveille d’un rêve, la faille entre « c’est un accident » et « bon dieu c’est un attentat », les bombardiers B1 qu’ils persistent à construire, les représailles et les représailles aux représailles et les représailles des représailles aux représailles, O Barrio de Barrières, notre république de la peur.
Assez d’élasticité pour osciller dans le vent, assez de rigidité pour qu’on ne s’en aperçoive pas : Babel c’est du bubble-gum qui vous colle au visage.
Babel est présence, Babel est absence : rien que la célébration de la présence. No mas aux explosions sacrées, no mas à l’occupation de la terre : explosions sacrées, occupation de la terre.
Babel c’est un homme qui hurle en sautant dans le vide quand aucun autre ne l’entend ; Babel c’est ce moment où l’on s’imagine pouvoir voler, un instant qui dure à jamais dans l’inconscient de Babel.
Babel est un rayon de soleil qui se fracasse au sol, un ruissellement de rayons qui se fracassent au sol, un champ miné de lumière.
La Tour de Babel : ça boume ?
Si l’architecture est de la musique figée, alors ces décombres calcinés et tordus sont ses mélodies, ses cimetières incandescents – Babel devenu ce qui supplie de la chanter.
1
“C’est très précisément dans l’ardeur de la guerre qu’ont lieu ces profondes convulsions sociales qui détruisent les vieilles institutions et remodèlent l’homme, en d’autres termes, les semences de la paix germent dans les dévastations de la guerre. L’aspiration de l’homme pour la paix n’est jamais plus intense qu’en temps de guerre. Il s’ensuit qu’aucune autre circonstance ne façonne une détermination aussi ferme à changer les conditions qui produisent la guerre. L’homme apprend à construire des barrages lorsqu’il a subi des inondations. La paix ne peut se forger qu’en temps de guerre.” Wilhelm Reich, La psychologie de masse du fascisme (1933)
Combien de vagues la lune a‑t-elle générées dans le Golfe persique depuis 1991 ?
Combien de vagues la lune et l’Atlantique ont-ils ensemble créées depuis 1491-et-demi ?
Quelle est la somme des rouleaux qui sont montés du fond des mers de notre terre avant même le début de la vie ?
Peut-on s’imaginer le nombre de vagues qu’a pleurées le Pacifique depuis Nagasaki et Hiroshima ?
Ils déploient des drapeaux comme les chevaux portent des œillères ; ils déploient grande abondance de drapeaux. Ils veulent des guerres, sans le savoir.
Ils montrent le chemin de la guerre, certains le savent d’autres pas ; ils agitent des drapeaux comme le matador agite sa muleta.
Chacun souffrant en silence dans le silence de son lit à lui, à elle ; deux robinets gouttent à contre-temps ; trois lavabos, quatre, cinq lavabos, chacun avec un robinet qui goutte ; toutes les mers fouettées et ballottées par des vents colossaux.
La Tour de Babel : prisonnière des terres, un chantier abandonné où viennent se servir les fermiers d’alentour.
La Tour de Babel : dans le texte il y a d’abord un Déluge.
A l’intérieur d’une chute au Nouveau Mexique il y a plus que de l’eau, plus que la pesanteur, moins que tout ce que la vulgarité de cet instant ne pourrait jamais exprimer.
Il est naturel que l’eau tombe. Il est naturel que l’eau tombe de falaises et il est naturel que des tours fondent si elles sont exposées à une chaleur excessive. Cela s’applique aussi aux cabanes. 7 octobre 2001.
Les huttes de terre ont leur propre façon de tomber, d’être destructivement transformées. 8 octobre 2001.
La mort de la paix s’est produite il y a longtemps mais n’a été marquée ni d’une pierre ni d’une date.
Les guerres viennent en vagues.
Les dégâts collatéraux, c’est une figure de style mais la pleine force du texte frappe l’adversaire du texte.
Poésie : mort sans paix.
6 août 1945 : mort sans fin.
Mourir chaque mort. Refuser de tuer. 11 octobre 2001.
12 octobre 2001 : non, ça c’est l’argent de mes impôts.
Quand le deuil même cède à la complaisance. Le discours de Bush à la Nation, 20 septembre 2001.
La Nation se vautre dans son deuil, les fautes de la Nation sont glorifiées, auréolées, transformées en moments héroïques, actes sacrificiels : actes qui n’auraient pas été nécessaires si des fautes avaient été évitées parmi les dirigeants, l’élite ; et de fait on peut vraiment dire que ceux qui ont péri se sont sacrifiés pour les péchés des maîtres du pétrole. Automne 2001.
Ni innocents, ni méritant la force de ces flammes : nul ne mérite la force de ces flammes, nul n’est innocent.
Deuil. Rien que deuil. Sans se parer de gestes héroïques, privé de cette consolation d’héroïsme dont on dit qu’ont besoin les proches des morts. Mais les proches ont-ils vraiment besoin de voir leurs morts en héros ? Les proches n’ont-ils pas plutôt besoin de voir en leurs morts des victimes à qui la vie a été volée par une vaine dialectique d’extrêmes disproportionnés ?
Une autre sorte d’attitude : une autre sorte de mission : une autre sorte de vie intérieure.
Pas le pompier qui a amené sa sirène au rallye de la paix à Times Square et noyé tous les discours, tous les orateurs dans le hurlement de son métier : mais les pompiers fouillant la fosse commune qu’eux les premiers ont déclarée terre sacrée.
A l’intérieur d’une chute au Nouveau Mexique il y a plus que de l’eau, plus que la pesanteur, plus que le plongeon fatal, quelque chose qui subtilement est moins que ce qu’un monothéiste ne pourra jamais exprimer.
Le nombre de vagues pleurées par le Pacifique depuis Nagasaki et Hiroshima ne cesse de se multiplier.
Il est naturel que l’eau tombe. Il est naturel d’imaginer la fin du monde. En imaginant la fin du monde nous protégeons notre mode de vie.
En ces jours où les réponses sont proposées comme autant d’évidences, forgeons une nouvelle tour de Babel : non pas confusion mais des mots pour transmuer le silence d’un consentement frappé de mutisme – qu’il cesse d’être sidéré devant une seule autorité divine, un seul empire.
Qu’une nouvelle tour de Babel touche le ciel. Qu’une nouvelle tour de Babel s’incline à l’appel de la lune. Ishtar, Inch’allah, Quetzalcoatl. Babil babil babil.
2
Barry Bearak, The New York Times, 15 décembre 2001, Madou, Afghanistan :
Peut-être qu’un jour il faudra rendre compte de ce petit village de 15 maisons, toutes transformées en bouts de bois et poussière par des bombes américaines. Un jour le commandement militaire des États-Unis pourrait expliquer pourquoi 55 personnes sont mortes le 1er décembre… Mais il est plus probable que Madou n’apprendra jamais si les bombes sont tombées par mégarde ou ont été lâchées délibérément et que cet incident sera oublié parmi les conséquences plus graves de la guerre. Restera un hameau anonyme avec des habitants anonymes enterrés dans des tombes anonymes… Même les alliés anti-Taliban des Etats-Unis se sont récriés, horrifiés, qu’il y avait eu des erreurs de cible provoquant la mort de centaines d’innocents. C’était ‘comme un crime contre l’humanité’, a dit Hajji Muhammad Zaman, un officier de la région.
Les cultivateurs de Madou sont en pièces détachées. Ils sont devenus leur propre engrais… si vient la pluie, nous leur avons rendu service, suggère une caricature présentant le Secrétaire de la Défense R. (gros rire). Mais nous n’avons pas besoin de ce genre de trait. Nous avons déjà bien consolidé le concept de dégâts collatéraux.
Celui qui voit avec le cœur, comme dirait Octavio Paz, se voit en Madou ; et qui ne peut voir Madou avec le cœur ? (‘Des hommes à l’esprit fossile, à la langue pétrolifère’, suggère le trait du caricaturiste.)
Chaque visage, un masque ; chaque maison une ruine de bois et de torchis.
Qui a perdu ses sœurs ? Les dégâts collatéraux ne peuvent jamais le prédire. (Les terroristes ne visent pas des sœurs en particulier.) (L’attaque américaine a eu lieu en quatre vagues successives.)
Après Madou, écrire de la poésie est indécent. (Theodor Adorno)
Il nous faut encore trouver les corps
beaucoup de couches dans ces décombres
et maintenant c’est avec ça que nous vivons
mystère :
Ainsi parlait M. Gul, habitant âgé de Madou,
Il aurait pu parler de Manhattan.
« Vieillard accablé » « barbe blanche » « front ridé » :
« puis Paia Gul » « jeune homme » « le regard amer » : « ‘j’accuse’ »
« ‘les Arabes’ » « puis corrigeant ses propres » « dires »
« ‘J’accuse les Arabes’ » « ‘et les Américains’ »
« ‘ils sont tous terribles’ »
« ‘ils sont tous les pires du monde’ »
« ‘la plupart des morts étaient des enfants’ »
Senteurs chants d’oiseaux champs de blé
M. Bearak sur place quinze jours après l’apocalypse.
Récoltent la ferraille des bombes,
espèrent survivre à l’hiver.
Au-delà de l’anecdote s’élève un hymne que nous ne pouvons qu’ébaucher, humbles faiseurs, les oiseaux gribouillant dans l’éphémère saisissant de l’air, les vrais auteurs.
En me rendant dans le potager
tard le soir, j’ai découvert
avec surprise la tête de ma
fille qui gisait sur le sol.
Ses yeux révulsés me fixaient, comme en extase…
(De loin on aurait dit
une grosse pierre, dans un halo de lumière,
comme jetée là par le Big Bang.)
Que diable fais-tu là, lui dis-je,
Tu as l’air ridicule.
Des garçons m’ont enterrée ici,
Fit-elle d’un ton boudeur.
Araki Yasusada, Double Flowering (Floraison double), alentours d’Hirohima, 25 décembre 1945
Cratères. Carcasses de tracteurs. Moutons morts.
Jarre aplatie en disque ;
insoutenable, « involontaire », non-américain
Ax Americana ;
loin de la Mecque, à Madou, Tora Bora,
une seule chambre intacte.
Impossible d’enterrer la colère.
La prière est parfaite quand celui qui prie ne se souvient pas qu’il prie.
Tout ce qui est mort tremble. (Kandinsky)
Note : Courriel au journaliste, lui demander s’il y avait des rangées de peupliers.
Pierre de lune aspirée dans l’atmosphère des arts rabougris ; pas de Héros pas de Néron non plus ; la face qui nous regarde cette nuit est pleine.
Comme le dit l’Upanishad Kaushitaki, « le souffle de vie est un. »
Le mot ‘Madou’ est la transcription d’un nom pachtoune tel que le reporter l’a entendu.
‘Madou’, ‘ma douce’.
3
Il s’imaginait être le sage célèbre qui avait réussi à parler au sable du désert.
Pas bien sage à lui de rendre le sable qu’il arpentait aussi fameux.
Était-il sage que cet homme bien habillé entouré de silence continue à babiller quand il n’y avait personne ?
Il y avait beaucoup d’air. Très chaud.
Vingt-et-un pas dans le désert et la route s’efface de la vue. Tout sens de l’orientation quitte l’esprit comme un colibri. Nul ne saurait où vous êtes allé, vous non plus.
Les dunes se déplacent. La route disparaît même si vous ne bougez pas, immobile au milieu. On pourrait engager des gens pour balayer le sable. Mais pour ça il faut de l’argent.
Le silence du Taklimakan est très réputé.
Les Chinois ont construit cette route pour des camions-citernes. Pour leur passage. Et ils passent. Mais cela n’a guère d’importance ; des camions sont à peine des têtes d’épingle.
Il s’imaginait être le sage obscur qui avait appris à parler aux peupliers du désert.
« Comment vivez-vous dans le désert ? » demanda-t-il à un arbre particulièrement robuste, et il attendit. Car les lignes de vie sont d’essence ligneuse.
Dans l’éphémère saisissant de l’air, du rose tourbillonne d’un soleil en adieux, de l’énergie s’élève de dessous son feuillage, ou peut-être est-ce l’homme, l’homme que l’amour tourne lavande.
Et le peuplier du désert de répondre : « Mets une bavette. » Et d’ajouter : « Concède s’il te plaît le mot ‘calme’. »
Et l’homme s’en fut, sans être sûr d’avoir bien compris, sans être sûr d’avoir jamais parlé la langue des peupliers du désert.
Mais il mit une bavette. Il porta toujours sa bavette. De la chambre à coucher à la salle du conseil.
Quand ses collègues de la direction lui demandèrent ce qui se passait, il répondit calmement : « Je reste un petit enfant. »
L’avenir de l’esprit n’est jamais donné.
Evidemment le sage se fit virer.
La route disparut sous ses pieds.
Le sable irrite les premières sentinelles.
C’est la faute de mon vocabulaire, se dit-il.
Il me faut augmenter mon vocabulaire.
4
Commencer à construire la nouvelle Babel là où avant se dressait l’ancienne.
Babel c’est de l’eau qui gèle malgré l’éclat du soleil, par-dessus un grillage de devanture sur Broadway et la 168e rue ; Babel est un glaçon qui vous invite à venir le caresser de la chaleur de votre gant de cuir.
Reconstruire le bas de Manhattan, comme Hiroshima fut reconstruite, si limitée que soit par comparaison la récente destruction, des cormorans se sèchent les ailes dans un courant d’air chaud.
« Kom, tout près, à côté. Germanique : ga, vieil anglais ge, ensemble. Latin cum, avec. Forme suffixée : kom-tra, en latin contra, contre, forme suffixée kom-yo, en grec koinos, commun, partagé. »
Ainsi : il est venu le temps de jouir, il est passé le temps de jouer à la guerre. (Patriotisme comme libido débile.)
Babel, c’est la seule arme acceptable, une langue dans ta bouche, puis la langue d’une autre dans ta bouche, une langue dans la bouche est la seule arme acceptable et voici que vient la langue d’un autre.
Babel n’est jamais marchandise ; Babel n’est jamais au grand jamais marchandise, puisque la marchandise l’abat.
Libérons le désir de la marchandise, même si la lingerie est désirable ; Babel est contradiction sans hypocrisie, marchandise qui engendre l’amour.
Babel, ce sont des mains sur les épaules, des caresses sur les seins, bois de pommier qui brûle sans cesse, bois de cerisier qui brille sans cesse, brumes qui se dégagent de muscles et de lèvres humides.
Comment rimer tout un séquoia ? Telle est la fleur qui pousse dans le cerveau de Babel.
Babel c’est un ventre aussi plat qu’un livre, une courbe aussi douce qu’une dune, un rêve aussi souple qu’une gymnaste
Un pénis qui se niche dans la bouche, une chatte qui encercle le majeur : le cocon du babil.
Babel c’est le désir d’affirmer quand on sait que c’est impossible, un renflement dans le pantalon aussi doux que le roc où grave le faiseur de pétroglyphes ; Babel c’est un nez trop long qui pourtant vous excite, un rebondissement dans le débat qui vous laisse sans voix, les prophètes bibliques quand ils reculent dans une terreur sacrée, des tunnels dans le crâne qu’aucune étincelle n’a jamais parcourus, apprendre pas seulement à manœuvrer le gouvernail mais à s’y abandonner.
Babel c’est le léopard des neiges dont la présence impose le silence, un tigre que vous devenez au moment où vos paupières se ferment, un chien qui renifle le derrière d’un autre ; Babel est une hyène propre et une hyène sale, une hyène propre et une hyène baveuse, une hyène propre et un suricate au museau affreusement pointu.
Babel est la bulle sans cesse en train d’éclater, les banques en banqueroute, le plaisir qui ne coûte que votre énergie à le créer.
Babel est une série de caresses qui se fondent l’une en l’autre.
Babel implique que vous décidiez de sortir nu-tête sous les tempêtes du Seigneur afin de saisir de vos mains l’éclair du Père et d’offrir au peuple ce don du Ciel, voilé dans votre chant. (Hölderlin)
Comme je suis prêt à t’honorer et à blasphémer contre toi dans un seul souffle, mon esprit mosquée où hommes et femmes se mêlent – Monsieur Dernier Dieu Monothéiste Encore Debout.
Babel est conscience et jouiscience, péni-science et cuni-science, con-sciences qui se goûtent ici et ici et ici…
Hypothèse de travail n°1 : précis pour s’aimer et non bombardement de précision.
5
Les nerfs ensevelis sous la burka, comme prescrit dans certains pays ; le regard qui ne rencontre que la burka, comme cela se passe dans certaines cultures : des territoires entiers où les hommes exigent les uns des autres qu’ils vivent sous la burka.
Pas le techno voile de la culture de consommation mais la techno burka sans trou pour la tête.
C’est une sensibilité sauvage, sauvage et délicate, marquée par la surabondance et la pénurie, scandalisée et anesthésiée par sa propre faim de violence. Ses ados flinguent leur propre école, leurs condisciples, puis se suicident. Leur culture est un masque de mort, la burka son insigne, hordes encagoulées ivres d’un culte de tueurs chosifiés qui font mal sans raison, engendrées par le marketing le plus sophistiqué.
La burka intérieure qui entrave l’apercevoir, la lourde burka qui est en moi, la burka opaque dont la présence nie toute réflexion, la burka obligatoire dans les sphères politiques, la burka en conserve qui cache le corps à son propre érotisme, la fausse opposition entre burka et bikini, et d’autres étranges coutumes de par là-bas : prétendre que le pouvoir ne s’enracine pas dans la pulsion sexuelle, faire porter cette pulsion à des enfants que rien n’y prépare.
Réfléchir sur soi illumine toujours les coins dissimulés, c’est du moins ce qu’enseignent les Lumières, la philosophie qui imprégnait les pères fondateurs : ‘l’œil qui ne veut pas voir dépérit’ (Duncan).
Pas d’Orientalisme, pas d’exotisme, pas de déshumanisation de l’autre : nos citoyens refusent désormais de porter la burka noire ou turquoise.
Pas de refuge dans le statut de victime, dans l’amnésie uniforme, dans la subjectivité encagoulée : les Américains ne veulent plus jeter de toile d’emballage sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, ne veulent plus loucher vers le monde de derrière leur burka de sécurité.
Pas de nationalisme qui nous aveugle sur les terribles crimes de la Nation : le Procureur Général ne jettera plus de burka sur les crimes qu’il commet lui-même, ni le Ministre de la Défense.
Pas de fausse modestie, pas de faux-fuyants ; la Présidence et autres instruments du capital ne sont plus cachés par leur diverses et multiples burkas.
Les papiers qui s’envolent des fenêtres en feu de la Tour de Babel indiquent que les mots sont tout ce qui reste ; le papier survit là où se brisent os et poutres. Aussi Babel n’est jamais burka et les hommes doivent honorer les morts avec des mots.
Babel survit à la révélation de son propre mystère, comme les femmes ; la burka n’est que sa masse sans forme.
La burka c’est le triomphe du masculin sur le féminin, qui bannit le féminin de la vie publique, comme les mots sont bannis de la vie publique dans une culture où la réalité des mots est cachée.
Babel c’est le masculin qui aspire à atteindre le féminin et sans cesse échoue, et retombant se met à se vivre dans tout son potentiel de semence.
Babel est l’ambition féminine et la potentialité de toute chose, y compris de ces cellules spécialisées qui aspirent à la verticalité.
Si seulement on pouvait s’emparer des étoiles mortes et rassembler toutes ces pierres en un seul lieu pour construire une tour…
Et pourtant le corps flotte dans un placenta de mots et aucun mot n’est compréhensible s’il n’émerge tout frissonnant d’entre les jambes, nu comme l’espace entre les jambes et en un clin d’œil devient hurlement, puis retombe, n’est plus que les mots qu’il a rapidement dispersés…
C’est une petite épine qui perce le ballon géant. (Oppen). C’est le sperme dans sa course à l’œuf. Ce nerf qui n’a rien à voir avec la sécurité ou la contre-sécurité.
Hypothèse de travail n°2 : précis pour s’aimer et non bombardements de précision.
Et plus jamais la burka.
6
| bulle |
libido |
cerveau |
Pentagone |
réclusion |
| village |
Allah |
chants d’oiseaux |
sœurs |
lavande |
| métal |
mystère |
Emir |
Américain |
glaçon |
| enfants |
marguerites |
plumes |
torchis |
phallique |
| mouton |
Quetzalcoatl |
aéroport |
orphique |
Président |
| feu de vie |
bavoir |
fermier |
féminin |
potager |
| pierre de lune |
Mecque |
Manhattan |
Madou |
perception |
| pierre de lune |
Mère |
peuplier |
barrage |
prière |
| Ax |
courriel |
halo |
fille |
centre-ville |
| baiser |
oriental |
précision |
deuil |
écossais |
7
Ce que l’on vénère n’est pas en haut. Tu l’as souvent embrassé près des flancs lisses du chêne vivant, ce qui explique que tu le sais à la périphérie, pensée visuelle et non visuelle, un allant mouillé entre les jambes, un lien entre réalités contingentes et la tour de Babylone, pour lequel il nous faut encore trouver un mot adéquat.
Les pots de fleurs se cassent tout autour, les carapaces de tortue perdent leurs marques en cet instant où la ville semble se défaire. C’est comme la Révolution Culturelle qui recommencerait, les Pères envoyés à la campagne, la rupture définitive avec la Mère, Central Park qui s’étire au ralenti vaste espace parsemé de passants figés dans leur incrédulité. Tu savais que ta peau aurait à jamais faim, que les larmes et leur accompagnement sonderaient à jamais l’absence de mots ; des affiches en Gros Caractères seraient la grande affaire du jour, et aller bousculer des repaires de tigres. En décembre de l’eau verte stagne dans le cratère.
Pourtant « la guerre insatisfaite et plus profonde sous et derrière la guerre déclarée » (Duncan), les conflits d’égoïsmes, les hooligans de la démesure, les milices, les politiques du chaos, le pouvoir du pétrole, tout cède à une dialectique plus vaste. L’abondance explose de partout, la plénitude passe à toute allure, d’autant plus déchirante qu’elle est belle : rochers et soleil aveuglant.
Et les langues étaient tant étonnées que chacun devenait étranger à son ami si bien que même mari et femme ne savaient plus comment se parler… des assassins occupés en plein jour, et il ne reste que ces perceptions disposées en petits paquets de résolution dynamique, mémoire et anticipation face à face, sachant depuis toujours que le devoir imposé est quasi impossible : comment récupérer les mots de la tribu ? Confondant.
Le sable irrite les premières sentinelles.
« Sauvez ceux qui pleurent » (Eluard).
Ce que l’on vénère n’est pas en haut. Car nous sommes déjà à l’étage supérieur. Comme Bina, en bengali, désigne l’instrument dont Saraswati, la déesse de l’étude, se devait de pincer les cordes. Sens comme ces cordes sont tendues. Souviens-toi de ces livres aux couvertures et pages de titres arrachées, et donc sans titres ni auteurs : des mots lus dans leur forme la plus pure, des livres acquis en douce, un incendie dont on accepte enfin qu’il est impossible à éteindre.
Ce que l’on vénère n’est pas en haut. Car nous sommes au niveau du sol. Parmi des plantes mystérieuses tu te baignes dans les rayons de celle qui est ton soleil et pourtant est couchée en dessous de toi, comme une fondation. Fais glisser tes doigts entre ses orteils. Fissures d’une source qui révèle merveille sur merveille.
Les choses s’assemblent bien dans leur propre rondeur ; une cigogne perche sur le cyprès, partie de tout un écosystème, sans capitale ni centre.
Le temps vraiment rajeunit.