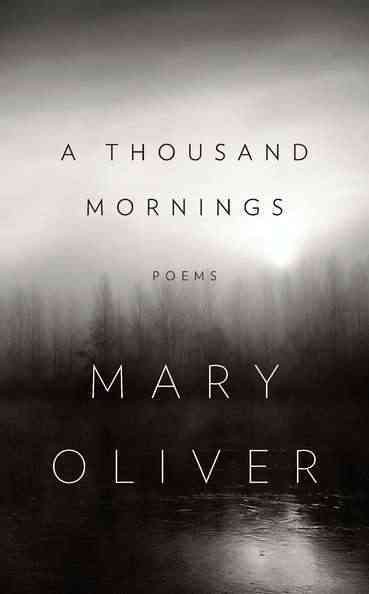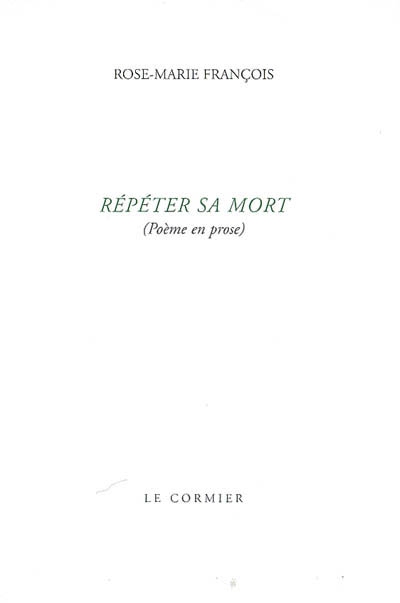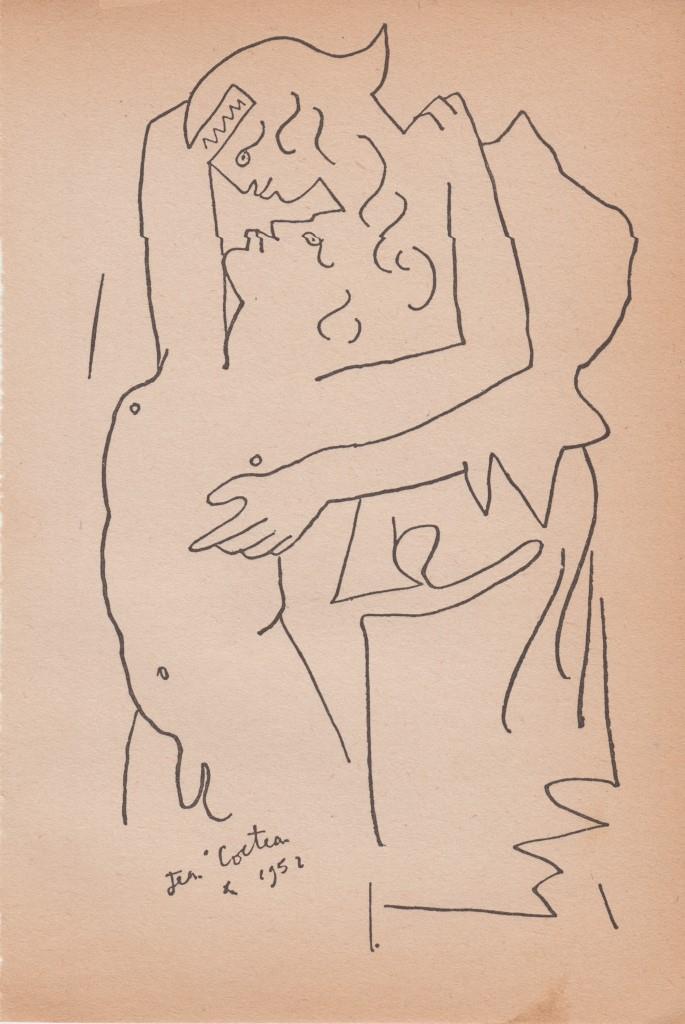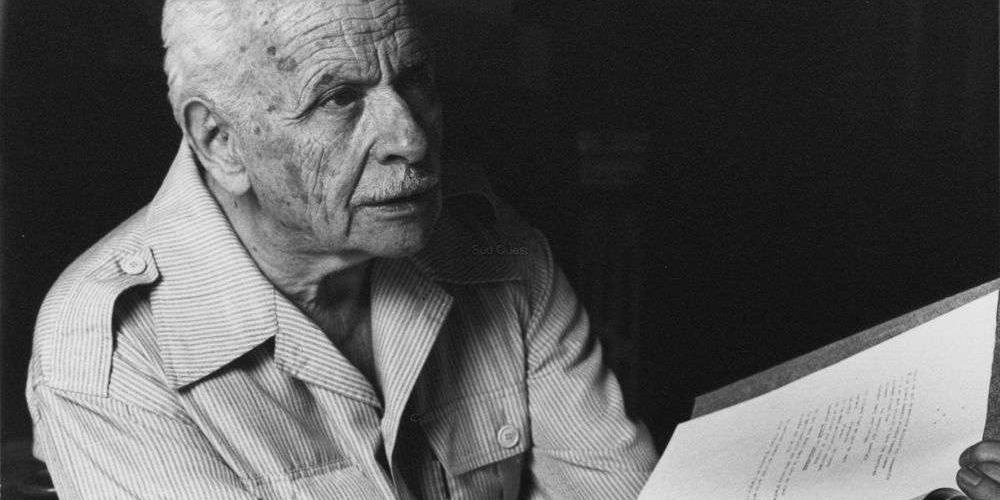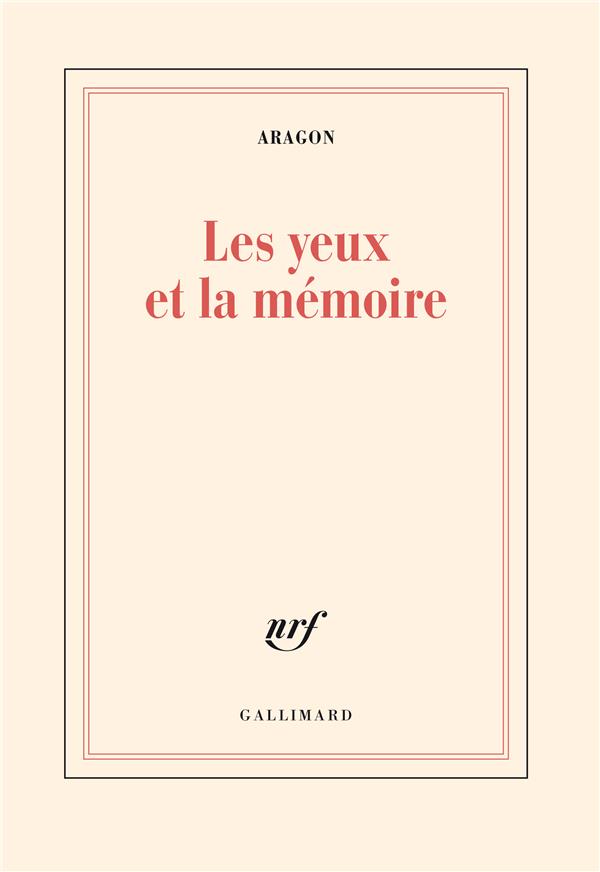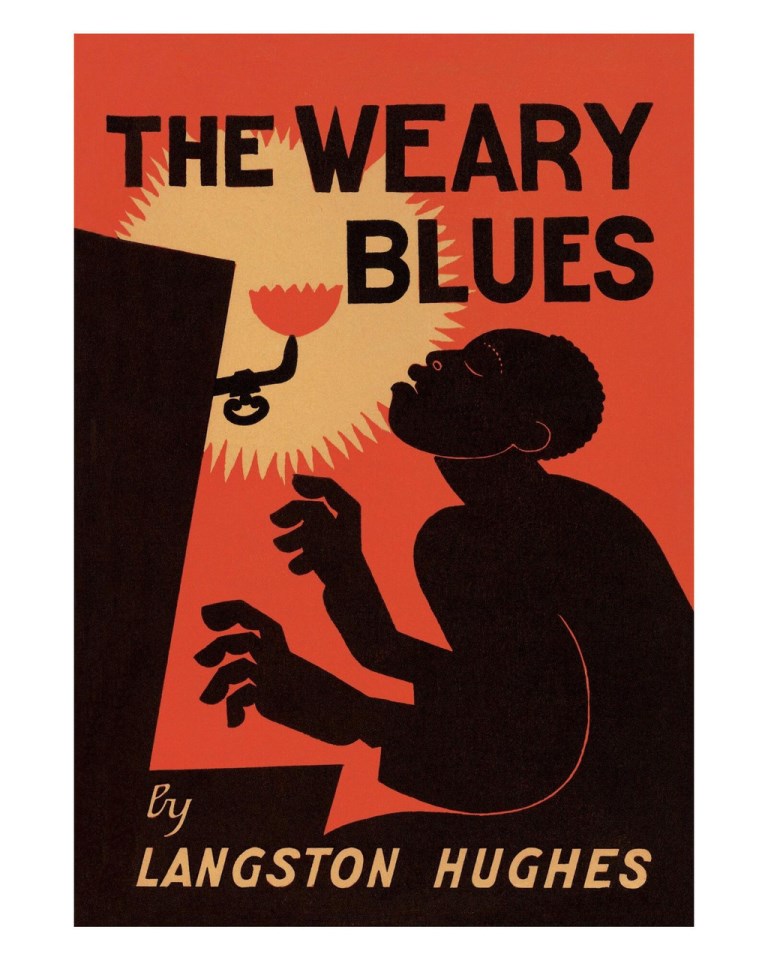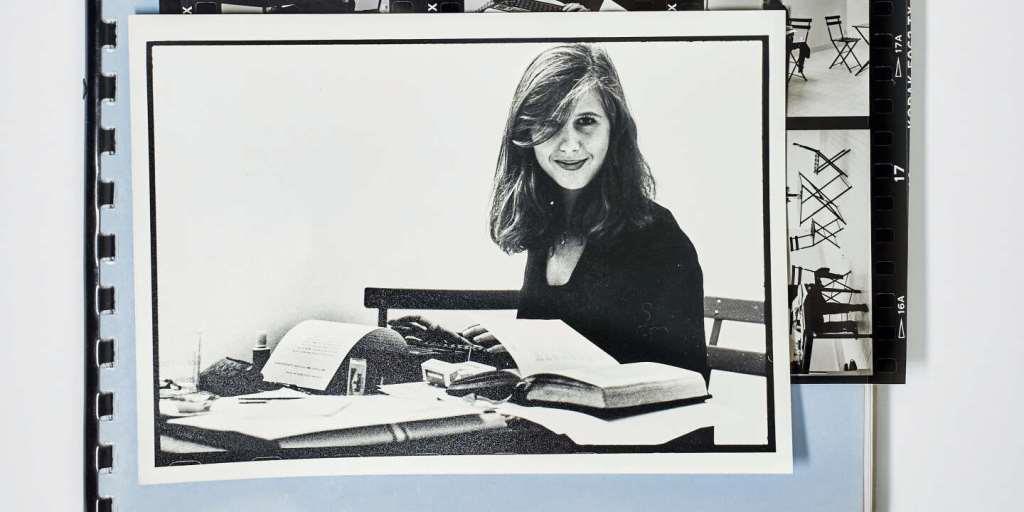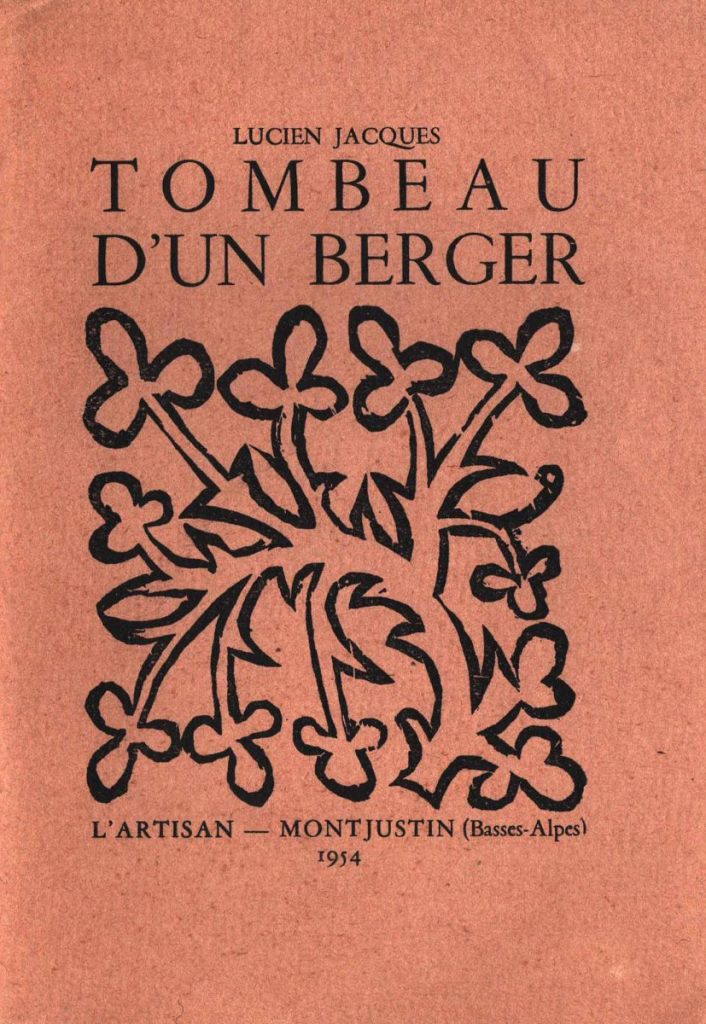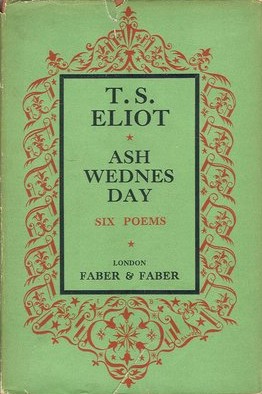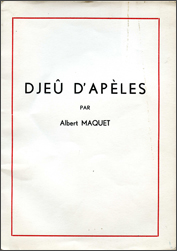I. PARCE QUE N’AI ESPOIR DE TOURNER ENCORE
Parce que n’ai espoir de tourner encore
Parce que n’ai espoir
Parce que n’ai espoir de tourner
Désirant le talent de celui-ci la vision de celui-là
Je ne tends plus à tendre vers ces choses
(Pourquoi l’aigle vieilli étirerait-il les ailes ?)
Pourquoi regretterais-je
Le pouvoir disparu du règne d’ici-bas ?
Parce que je n’ai espoir de connaître encore
La gloire infirme de l’heure positive
Parce que je ne pense pas
Parce que je savais que je ne saurai point
Le seul véritable pouvoir transitoire
Parce que je ne peux boire
Là où fleurissent les arbres, où coulent les sources, car il n’y a plus rien
Parce que je sais que le temps est toujours le temps
Et le lieu toujours et seulement le lieu
Et que ce qui est ne l’est que pour un temps
Et seulement pour un lieu
Je me réjouis que les choses soient ce qu’elles sont et
Je renonce au visage bienheureux
Et renonce à la voix
Parce que n’ai espoir de tourner encore
Par conséquent je me réjouis, devant me construire de quoi
Me réjouir
Et prie Dieu de prendre pitié de nous
Et prie de pouvoir oublier
Ces questions qu’en moi-même je trop débats
Trop explique
Parce que n’ai espoir de tourner encore
Que ces mots répondent
De ce qui est fait, n’est plus à faire
Que le jugement ne soit pas trop sévère
Parce que ces ailes ne sont plus ailes pour voler
Rien que vanneaux pour éventer
Un air désormais sec et étriqué
Plus sec et plus étriqué que la volonté
Enseigne-nous l’engagement dégagé
Enseigne-nous la patience.
Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l’heure de notre mort
Priez pour nous maintenant et à l’heure de notre mort.
II. DAME, TROIS LÉOPARDS BLANCS ÉTAIENT ASSIS SOUS UN GENÉVRIER
Dame, trois léopards blancs étaient assis sous un genévrier
Dans la fraîcheur du jour, repus
De mes jambes mon cœur mon foie et ce qui était contenu
Dans le creux de mon crâne. Et Dieu dit
Ces os vivront-ils ? faut-il que ces
Os vivent ? Et ce qui était contenu
Dans les os (qui étaient déjà secs) répondit d’une petite voix :
Grâce à la bonté de cette Dame
Et grâce à sa beauté, et parce qu’elle
Honore la Vierge en méditation,
Nous resplendissons. Et moi qui suis ici dispersé
Je voue mes gestes à l’oubli, et mon amour
À la postérité du désert et au fruit de la gourde.
C’est là ce qui reçoit
Mes entrailles l’attache de mes yeux et les portions indigestes
Que rejettent les léopards. La Dame s’est retirée
En robe blanche, en contemplation, en robe blanche.
Que la blancheur des os expient jusqu’à l’oubli.
Il n’y a pas de vie en eux. Comme je suis oublié
Et veux être oublié, de même je veux oublier
Ainsi consacré, concentré dans un but. Et Dieu dit
Prophétise au vent, rien qu’au vent car seul
Le vent écoutera. Et les os chantèrent d’une petite voix
Sous le fardeau de la sauterelle, pour dire
Dame des silences
Calme et désolée
Déchirée et entière
Rose de la mémoire
Rose de l’oubli
Épuisée et généreuse
Soucieuse sereine
La Rose unique
Est désormais le Jardin
Où finissent tous les amours
Se termine le tourment
De l’amour insatisfait
Le tourment plus grand
De l’amour satisfait
Fin de l’infini
Voyage vers nulle fin
Conclusion de tout ce qui ne peut
Se conclure
Parole sans mot et
Mot sans parole
Grâce soit rendue à la Mère
Pour le Jardin
Où finissent tous les amours.
Sous un genévrier les os chantaient, éparpillés et resplendissant
Nous sommes heureux d’être éparpillés, nous ne nous sommes guère entre-aidés,
Sous un arbre dans la fraîcheur du jour, avec la bénédiction du sable,
S’oubliant eux et les autres, unis
Dans le silence du désert. Voici la terre que vous vous
Partagerez. Et ni division ni unité
N’a d’importance. Voici la terre. Nous avons notre héritage.
III. AU PREMIER COUDE DE LA DEUXIÈME VOLÉE
Au premier coude de la deuxième volée
Je me retourne et vois plus bas
La même forme penchée
Dans la vapeur d’un air vicié
Aux prises avec le diable des escaliers dissimulé
Sous le masque fourbe d’espoir et désespoir.
Au second coude de la deuxième volée
Je les ai laissés s’entre-déchirer ;
Il n’y avait plus de visages, l’escalier était obscur,
Humide, plein de trous, comme la bouche radotante d’un vieillard, irréparable,
Ou la gueule d’un requin sur le retour.
Au premier coude de la troisième volée
Il y avait une fenêtre arrondie comme le fruit du figuier
Et par-delà des fleurs d’aubépine et une scène pastorale
Le personnage bien bâti habillé de bleu et de vert
Enchantait le joli mai d’un air de flûte.
Les cheveux au vent sont doux, cheveux bruns que le vent rabat sur la bouche,
Lilas et cheveux au vent ;
Distraction, musique de flûte, pauses et pas du mental sur la troisième volée,
Qui s’efface, s’efface ; force au-delà d’espoir et désespoir
Escaladant la troisième volée.
Seigneur, je ne suis pas digne
Seigneur, je ne suis pas digne
mais dis seulement un mot.
IV. QUI MARCHAIT ENTRE LA VIOLETTE ET LA VIOLETTE
Qui marchait entre la violette et la violette
qui marchait entre
Les rangées diverses de verts variés
S’avançant en blanc et bleu, aux couleurs de Marie,
Parlant de banalités
Dans l’ignorance et la connaissance d’une douleur éternelle
Qui se mouvait parmi les autres qui marchaient,
Qui a ravivé les fontaines et renouvelé les sources
Rafraîchi le rocher desséché et affermi le sable
En bleu pied d’alouette, bleu couleur de Marie,
Sovegna vos
Voici les années qui s’interposent, emportent
Flûtes et violons, ramenant
Celle qui arrive à l’heure entre sommeil et veille, enveloppée
De plis de lumière, habillée de ses plis.
Les années nouvelles s’avancent, ramenant
Dans un nuage de larmes, les années, ramenant
D’un nouveau rythme l’ancien refrain. Rachète
Le temps. Rachète
La vision non déchiffrée dans le rêve plus élevé
Tandis que des licornes endiamantées tirent le corbillard doré.
La sœur silencieuse voilée de blanc et bleu
Entre les ifs, derrière le dieu du jardin,
Dont la flûte est sans voix, pencha la tête et soupira mais ne dit rien
Mais la fontaine jaillit et l’oiseau siffla
Rachète le temps, rachète le rêve
Le signe du mot non ouï, non dit
Jusqu’à ce que le vent secoue de l’if un millier de soupirs
Et après, notre exil
V. SI LE MOT PERDU EST PERDU, SI LE MOT DÉPENSÉ EST DÉPENSÉ
Si le mot perdu est perdu, si le mot dépensé est dépensé
Si le mot non ouï non dit
Est non dit, non ouï ;
Pourtant le mot non dit, le Mot non ouï,
Le Mot sans mot, le Mot au sein
Du monde et pour le monde ;
Et la lumière brillait dans l’obscurité et
Contre le Mot le monde inquiet s’émouvait sans cesse
Autour du centre du Mot silencieux.
Ô mon peuple, que t’ai-je fait.
Où trouver le mot, où le mot
Retentira-t-il ? Pas ici, il n’y a pas assez de silence
Pas sur les mers ni sur les îles, pas
Sur les continents, dans le désert ou les marais,
Pour ceux qui marchent dans l’obscurité
Que ce soit le jour ou la nuit
Ce n’est ni le moment ni le lieu
Pas de lieu de rédemption pour ceux qui se détournent
Pas de moment de réjouissance pour ceux qui marchent dans le bruit et nient la voix
La sœur voilée priera-t-elle pour
Ceux qui marchent dans l’obscurité, qui te choisissent et te combattent,
Ceux qui sont déchirés sur les cornes entre saison et saison, temps et temps, entre
Moment et moment, mot et mot, pouvoir et pouvoir, ceux qui attendent
Dans l’obscurité ? La sœur voilée priera-t-elle
Pour les enfants à la barrière
Qui ne veulent pas s’en aller et ne peuvent prier :
Priez pour ceux qui choisirent et combattirent
Ô mon peuple, que t’ai-je fait.
La sœur voilée entre les ifs frêles
Priera-t-elle pour ceux qui l’ont offensée
Et sont terrifiés et ne peuvent se rendre
Et affirment devant le monde et nient entre les rochers
Dans le dernier désert avant les derniers rochers bleus
Le désert dans le jardin le jardin dans le désert
De sécheresse, recrachant le pépin racorni.
Ô mon peuple.
VI. MÊME SI JE N’AI ESPOIR DE TOURNER ENCORE
Même si je n’ai espoir de tourner encore
Même si je n’ai espoir
Même si je n’ai espoir de tourner
Vacillant entre profit et perte
Dans ce bref transit où les rêves se croisent
La pénombre traversée de rêves entre naissance et mort
(Bénissez-moi mon père) même si je ne souhaite pas souhaiter ces choses
De la fenêtre ouverte sur la côte de granit
Les voiles blanches fuient encore vers le large, vers le large fuyant
Leurs ailes pas brisées
Et le cœur perdu se raidit et se réjouit
Du lilas perdu et des voix perdues de la mer
Et l’esprit défaillant se ravive et se rebelle
Pour les verges d’or et l’odeur perdue de la mer
Se ravive et retrouve
Le cri de la caille les voltes du pluvier
Et l’œil aveugle crée
Les formes vides entre les portes d’ivoire
Et l’odorat retrouve la saveur salée de la terre sablonneuse
C’est le temps de la tension entre mourir et naître
Le lieu de solitude où trois rêves se croisent
Entre les rochers bleus
Mais quand les voix secouées de l’if s’en vont à la dérive
Que l’autre if réponde d’une autre secousse.
Sœur bienheureuse, sainte mère, esprit de la fontaine, esprit du jardin,
Ne nous laisse pas nous abrutir d’illusions
Enseigne-nous l’engagement dégagé
Enseigne-nous la patience
Même parmi ses rochers,
Notre paix dans Sa volonté
Et même parmi ces rochers
Sœur, mère
Et esprit du fleuve, esprit de la mer,
Ne me permets pas d’être séparé
Et laisse mon cri monter vers Toi.